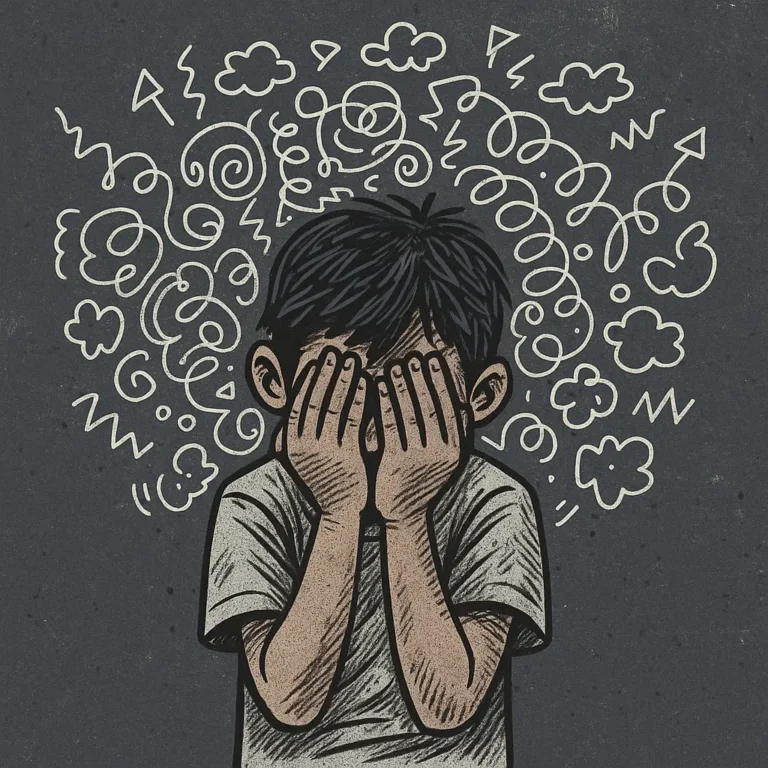Vivre avec un trouble borderline
« C’est comme ressentir tout trop fort, tout le temps… »
— témoignage issu de la vidéo VTFS – Trouble borderline
Le trouble borderline n’est pas une exagération de la sensibilité, ni une lubie passagère. C’est une manière d’être au monde où les émotions prennent toute la place, où les liens sont à la fois vitaux et terrifiants, et où l’identité semble parfois se dissoudre. Cet article propose une plongée dans l’expérience vécue des personnes concernées — et dans ce que peut leur offrir un accompagnement psychothérapeutique bienveillant.
Un monde intérieur à vif
Vivre avec un trouble borderline, c’est ressentir le monde sans filtre. Une remarque anodine peut heurter comme une gifle. Un silence ou un retard de réponse peut ouvrir un abîme de solitude. Une dispute peut déclencher une crise de panique ou un effondrement.
« L’émotion déborde avant même que je puisse comprendre ce que je ressens. »
— extrait de la vidéo
Cette hypersensibilité émotionnelle n’est pas une faiblesse. Elle est souvent le fruit d’un passé marqué par l’insécurité affective, les ruptures précoces ou les traumatismes. Le système d’alerte interne est en état de vigilance permanente. Le danger est perçu partout — surtout dans les relations.
Une identité fragile et mouvante
« Je ne sais pas vraiment qui je suis » : cette phrase revient souvent. Les personnes borderline décrivent un sentiment de vide, une difficulté à se sentir stables dans leur identité. Elles changent de goûts, d’opinions, de projets. Elles peuvent se sentir comme des caméléons, s’adaptant à l’autre jusqu’à se perdre elles-mêmes.
Ce n’est pas du jeu ou du mensonge : c’est une conséquence de blessures profondes dans la construction du sentiment de soi. Quand les liens précoces sont marqués par l’instabilité, la trahison ou l’incohérence, il devient difficile de construire un « moi » solide.
Aimer à tout prix — et en souffrir
La relation à l’autre est à la fois une nécessité absolue et une source de menace. Les personnes borderline peuvent aimer intensément, se montrer disponibles, passionnées, fusionnelles. Mais ce même amour peut devenir incontrôlable, jaloux, envahissant, parfois destructeur.
« J’ai besoin de l’autre tout le temps, mais dès qu’il s’éloigne, je me sens trahie, humiliée. »
Il y a souvent une peur panique de l’abandon, qui pousse à tester l’autre, à provoquer, à s’accrocher — ou au contraire à couper brutalement. On passe de l’idéalisation à la haine, de l’attachement à la rupture, dans une spirale douloureuse et difficile à comprendre pour l’entourage.
Crises, passages à l’acte et stratégies de survie
Quand l’angoisse devient trop forte, certaines personnes se font du mal physiquement, consomment des substances, multiplient les conduites à risque ou s’isolent brutalement. Ce ne sont pas des caprices ou des manipulations. Ce sont des manières — souvent les seules connues — de faire baisser la pression émotionnelle.
« Quand je me scarifie, c’est pour me sentir réelle. Parce que là, au moins, je sens quelque chose. »
Ces comportements expriment une souffrance que les mots n’arrivent pas à dire. Ils méritent d’être accueillis avec compréhension, et non avec culpabilisation ou rejet.
Un diagnostic à manier avec précaution
Le terme « borderline » est parfois utilisé à tort et à travers. Or, poser un tel diagnostic est un acte délicat. Il doit être réservé à des professionnel·les de santé mentale expérimenté·es, et toujours accompagné d’une réflexion sur son utilité pour la personne concernée.
Car ce mot peut stigmatiser, figer, faire peur. Trop souvent, le terme est utilisé pour disqualifier, marginaliser ou pathologiser des femmes (car 75 % des personnes diagnostiquées sont des femmes), alors que le trouble est surtout un mode d’adaptation à une histoire de souffrance.
Il peut aussi soulager, en mettant des mots sur ce que l’on vit depuis longtemps. Mais surtout, il ne doit jamais devenir une étiquette définitive. Chaque personne est unique, bien plus que son diagnostic.
Le trouble borderline recouvre une grande variété de vécus et d’intensités. Certaines personnes peuvent vivre avec ces traits sans que cela ne prenne toute la place dans leur vie. D’autres sont en crise, en demande urgente d’aide. Il n’y a pas de portrait unique.
L’intérêt d’un accompagnement thérapeutique
Ce qui aide, au-delà des techniques, c’est avant tout la qualité de la relation thérapeutique. Une relation stable, sécurisante, où l’on peut peu à peu se sentir exister, penser, traverser les émotions sans les agir.
Accueillir ce qui déborde
La thérapie offre un espace où l’on peut mettre des mots sur la tempête intérieure. Où l’on apprend à reconnaître les émotions, à comprendre ce qui les déclenche, à ne plus les fuir ou les combattre systématiquement. À vivre avec elles, plutôt que contre elles.
Se réapproprier son histoire
L’accompagnement permet aussi de revenir sur les blessures anciennes, les attachements précaires, les ruptures. Non pour accuser, mais pour comprendre. Et ainsi sortir peu à peu de la répétition.
(Re)construire un sentiment de soi
Dans un cadre soutenant, on peut explorer ce qui fait sens pour soi : ses désirs, ses limites, ses ressources. Cela permet de commencer à se sentir un peu plus solide, un peu plus aligné·e avec soi-même.
Des approches complémentaires
Plusieurs approches thérapeutiques peuvent être aidantes :
Les thérapies dites dialectiques (DBT), qui proposent des outils concrets pour réguler les émotions et apaiser les crises.
Les thérapies centrées sur la mentalisation, qui aident à mieux comprendre ce que l’on ressent et à décoder les intentions des autres.
Les approches psychodynamiques, qui explorent l’histoire affective et les dynamiques inconscientes.
Mais aucune méthode ne remplace l’essentiel : la confiance entre la personne et son thérapeute, la régularité du lien, et le temps.
Être proche d’une personne borderline : entre soutien et limites
Aimer quelqu’un qui vit avec un trouble borderline peut être bouleversant, épuisant, déroutant. On se sent parfois impuissant·e, parfois agressé·e, parfois indispensable.
Il est important de poser des limites, de prendre soin de soi, tout en maintenant un lien soutenant. Il est utile d’inviter la personne à consulter, sans forcer. Et surtout, il est nécessaire de ne pas tout porter seul·e : des espaces de soutien existent aussi pour les proches.
Un message d’espoir
« J’ai mis du temps à comprendre que je n’étais pas “folle”, que je n’étais pas seule, et que je pouvais aller mieux. »
Le trouble borderline peut évoluer. De nombreuses personnes, avec un accompagnement adapté, parviennent à mieux se connaître, à vivre des relations plus stables, à exprimer leurs émotions sans les laisser les submerger.
Ce n’est pas un chemin facile. Il y a des rechutes, des résistances, des moments d’abattement. Mais il y a aussi des victoires : oser dire, ne pas fuir, rester en lien, se sentir vivant·e.
En conclusion
Être borderline, ce n’est pas être malade de l’amour ou fou de douleur. C’est vivre avec des blessures qui rendent la vie plus intense, plus risquée, mais aussi plus ouverte aux possibles.
Avec une écoute sincère, des mots justes, et un lien thérapeutique solide, les personnes concernées peuvent apprendre à ne plus se laisser déborder, à exister sans se perdre, à aimer sans s’effondrer.
Car derrière les crises, il y a toujours une personne. Une personne qui cherche, maladroitement mais courageusement, à être reconnue, aimée, et enfin, en paix.
Voici plusieurs liens vidéos pour synthétiser et/ou approfondir le sujet :
et un conseil lecture , très accessible et complet , sur lequel je me suis en partie appuyé pour cet article :
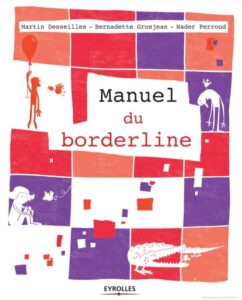
« Manuel du borderline » de Martin Desseilles , Bernatte Grosjean et Nadar Perroud , aux Editions Eyrolles