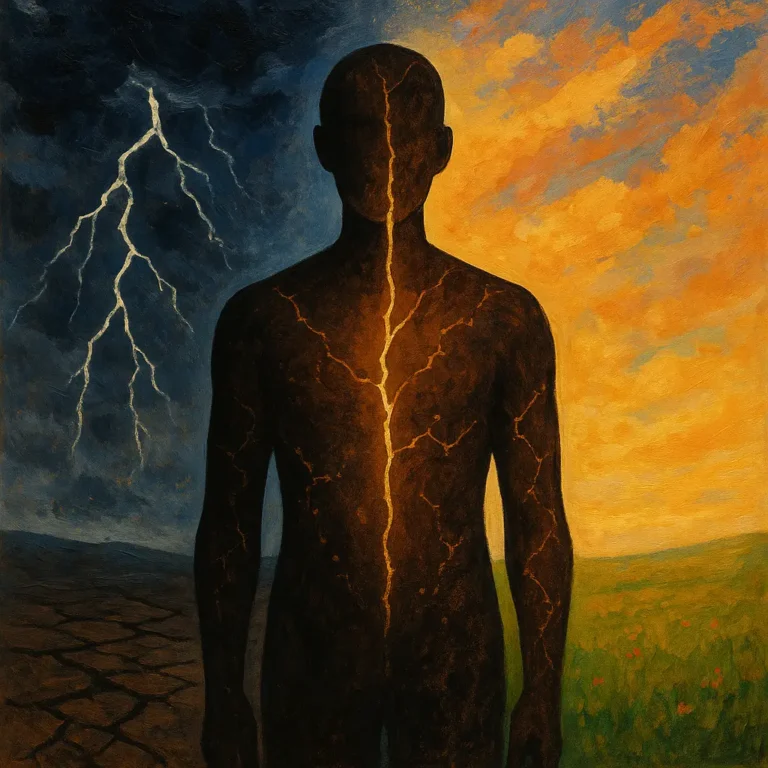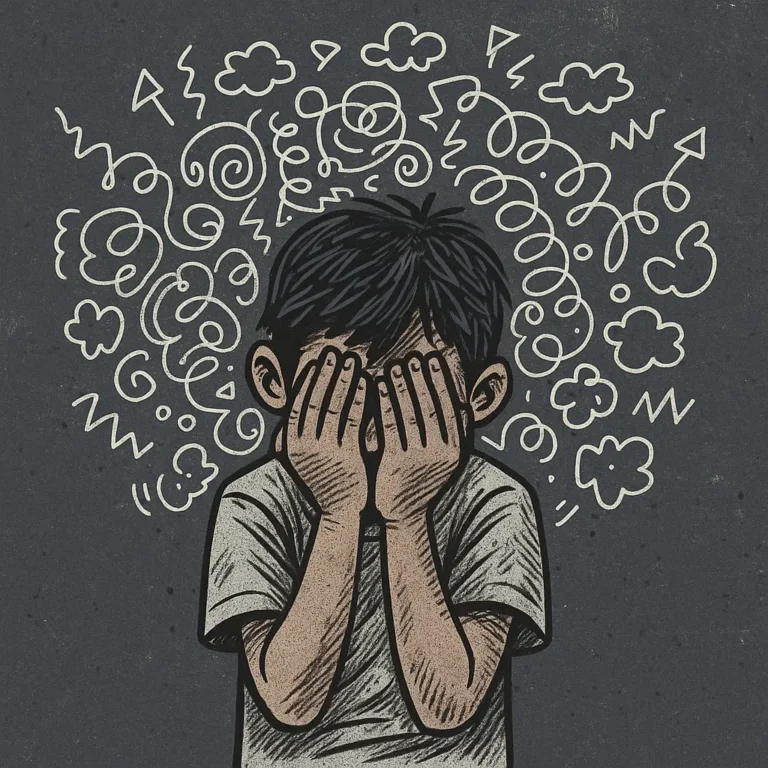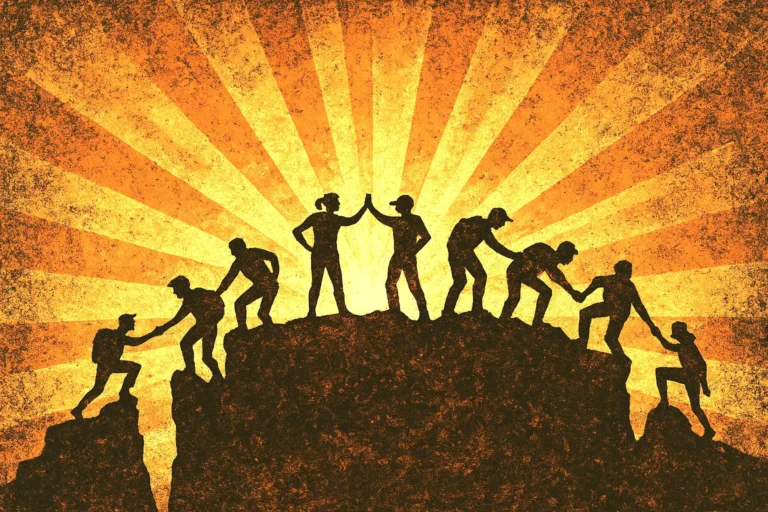Le validisme : penser les corps autrement
Dans nos sociétés, certains corps sont célébrés, d’autres sont ignorés, infantilisés, parfois même effacés. Le validisme, encore peu connu du grand public, désigne cette hiérarchie entre les corps valides et les corps en situation de handicap. Il s’inscrit dans un système de domination qui façonne notre manière de penser la norme, la force, la beauté, mais aussi l’autonomie et la valeur d’une vie humaine.
Qu’est-ce que le validisme ?
Le validisme, ou capacitisme (de l’anglais ableism), est un système d’oppression fondé sur la valorisation de certaines capacités physiques, mentales ou sensorielles au détriment des autres. Il repose sur l’idée implicite que le corps dit « valide » est la norme universelle, et que tout ce qui s’en éloigne est un échec, une anomalie ou un problème à corriger.
Cette logique s’exprime dans les discours, les politiques, l’architecture, les imaginaires culturels. Elle traverse les institutions, la médecine, la famille, l’école, le monde du travail. Elle n’est pas toujours consciente : comme le racisme ou le sexisme, le validisme est souvent intégré de manière inconsciente, à travers des réflexes, des représentations ou des habitudes.
Charlotte Puiseux, dans De chair et de sang, insiste sur cette forme de domination invisible :
« Le validisme n’est pas seulement un rejet ou un mépris explicite du handicap. C’est une manière de construire le monde qui, sans même s’en rendre compte, le rend inaccessible à celles et ceux qui n’entrent pas dans la norme. »
Un système de pouvoir
Le validisme n’est pas une simple question d’ignorance ou de maladresse. C’est un système politique et social qui produit de l’infériorisation. Il repose sur un rapport de pouvoir entre ceux qui définissent les normes et ceux qui doivent s’y conformer ou s’en excuser.
Dans un monde validiste, les personnes handicapées sont souvent réduites à leur condition. On ne les voit plus comme des sujets, mais comme des objets de soins, de pitié ou d’admiration. On attend d’elles qu’elles surmontent leur handicap (narration du héros), ou qu’elles se fassent discrètes (invisibilisation). Deux faces d’un même contrôle social.
La philosophe américaine Rosemarie Garland-Thomson, pionnière des disability studies, parle de la « construction culturelle du handicap ». Selon elle, ce n’est pas le corps en lui-même qui est handicapé, mais la société qui produit le handicap en ne prévoyant pas de place pour la diversité corporelle.
Ainsi, un escalier sans rampe, un site internet non accessible, ou un emploi réservé aux personnes « dynamiques » ne sont pas des évidences neutres. Ce sont des choix politiques, révélateurs de ce que la société considère comme légitime ou non.
Un peu d’histoire : entre soins et contrôle
L’histoire du validisme s’inscrit dans une longue tradition de gestion des corps « déviants ». À partir du XIXe siècle, avec l’essor de la médecine moderne, les corps handicapés sont de plus en plus pris en charge par des institutions : hôpitaux, asiles, écoles spécialisées. Si cette médicalisation permet parfois des avancées, elle enferme aussi les individus dans une identité pathologisée.
Les normes corporelles s’imposent alors comme des critères de civilisation et de productivité. Le corps utile est un corps sain, efficace, rentable. Les autres sont marginalisés, exclus ou corrigés. Cette logique s’intensifie au XXe siècle avec les grandes idéologies eugénistes, culminant dans les crimes nazis, où les personnes handicapées sont stérilisées, euthanasiées, éliminées au nom de la « pureté » ou de l’« amélioration » de l’espèce humaine.
Encore aujourd’hui, cette histoire pèse lourd. On retrouve dans certains discours contemporains sur le dépistage prénatal ou sur l’aide à mourir des échos troublants de ces idéologies. Comme le souligne Charlotte Puiseux :
« La tentation validiste consiste à nier la valeur des vies jugées dépendantes, douloureuses ou ‘incomplètes’. Mais qui décide de ce qu’est une vie digne d’être vécue ? »
Corps valides, corps légitimes
Dans une société validiste, la norme corporelle est présentée comme naturelle, mais elle est en réalité profondément politique. Elle privilégie l’autonomie, la performance, la jeunesse, la beauté standardisée. Ceux qui ne correspondent pas à cette norme — personnes en fauteuil, neuroatypiques, malvoyantes, polyhandicapées… — sont perçus comme en dehors du jeu social.
Le validisme se manifeste par des obstacles très concrets : bâtiments inaccessibles, manque d’aides humaines, précarité financière, discriminations à l’embauche. Mais aussi par des violences symboliques : infantilisation, invisibilisation, moqueries, injonctions à « faire des efforts », à « ne pas se plaindre ».
La philosophe Judith Butler, dans ses travaux sur la vulnérabilité, nous invite à repenser la notion d’autonomie :
« Nous sommes tous interdépendants. La fiction du sujet autonome masque le fait que la vie humaine repose toujours sur des relations de soutien. »
Autrement dit, il n’y a pas d’un côté les personnes « dépendantes » et de l’autre les personnes « autonomes ». Nous sommes tous, à des degrés divers, dépendants des autres, du soin, du collectif.
Le validisme comme oubli de notre propre vulnérabilité
Charlotte Puiseux invite à penser le corps autrement. Elle-même en situation de handicap moteur, elle dénonce l’assignation au silence, à la gratitude forcée, à la dépendance honteuse. Elle écrit :
« Le validisme empêche de penser la pluralité des existences corporelles. Il construit une image du corps idéal, et rejette tout ce qui pourrait en troubler la surface. »
Mais derrière cette norme rigide, il y a une peur. Peur de la fragilité, de la maladie, de la finitude. Le validisme n’est pas seulement une domination des valides sur les autres, c’est aussi une manière d’exorciser notre propre vulnérabilité.
Reconnaître cela, ce n’est pas sombrer dans la peur, c’est au contraire ouvrir la voie à une éthique du soin, de la solidarité, de l’adaptation mutuelle.
Intégrer la question du validisme en psychothérapie
Dans l’espace thérapeutique, la question du validisme mérite une attention particulière. Car le cabinet du psychanalyste ou du thérapeute n’échappe pas aux normes sociales qui hiérarchisent les corps. La relation thérapeutique elle-même peut être traversée, souvent malgré elle, par des représentations validistes.
Écouter une personne en situation de handicap demande plus qu’un accueil bienveillant : cela exige de déconstruire ses propres présupposés sur la norme, sur la santé, sur l’autonomie. Le handicap ne doit pas être réduit à une souffrance individuelle, ni essentialisé comme une identité figée. Il s’inscrit dans un contexte social, politique et symbolique. Le travail thérapeutique peut alors devenir un espace où ces dimensions sont mises en mots, revisitées, parfois transformées.
Charlotte Puiseux, qui est aussi psychologue clinicienne, insiste sur le besoin de « ne pas psychologiser à outrance » le handicap, mais au contraire d’en reconnaître les causes systémiques. Elle écrit :
« Trop souvent, le mal-être des personnes handicapées est renvoyé à leur histoire personnelle, comme si l’exclusion sociale, les violences institutionnelles, ou les humiliations du quotidien n’avaient aucun poids. »
En ce sens, intégrer la critique du validisme en psychothérapie, c’est ouvrir un espace pour que le sujet handicapé retrouve une parole propre, non réduite à une plainte ou à une adaptation. C’est reconnaître que la souffrance peut aussi venir de l’extérieur — de l’assignation, du rejet, de l’invisibilisation. Et que le désir de vivre, de créer, de se relier, n’est jamais aboli par la déficience, mais parfois empêché par le regard social.
C’est aussi un appel à repenser nos dispositifs : lieux accessibles, temporalités souples, écoute des vécus corporels singuliers. Offrir un cadre thérapeutique non-validiste, c’est reconnaître que tous les corps méritent de penser et d’être pensés.
Intersectionnalité du validisme
Il est essentiel d’ajouter que le validisme ne touche pas tout le monde de la même façon. Il se croise avec d’autres systèmes d’oppression : racisme, sexisme, classisme, transphobie. Une femme noire en situation de handicap n’est pas perçue ni traitée de la même façon qu’un homme blanc en fauteuil.
Ce croisement des discriminations, appelé intersectionnalité, est un outil indispensable pour penser la complexité des vécus. Il permet de sortir d’une vision homogène des personnes handicapées et de prendre en compte les réalités multiples de la domination.
Conclusion : pour une politique des corps pluriels
Le validisme n’est pas un accident. C’est une production sociale, politique, culturelle. Il découle d’une vision du monde où certains corps valent plus que d’autres, où la vulnérabilité est niée, où la norme devient tyrannie.
Penser le validisme, c’est donc penser la démocratie, le vivre-ensemble, le sens que nous donnons à la vie humaine. C’est refuser de classer les existences selon leur productivité ou leur conformité. C’est affirmer que chaque corps, chaque vie, a droit à la dignité, à la parole, à la présence.
Comme le dit Charlotte Puiseux, dans une formule simple et forte :
« Il n’y a pas de corps neutre. Tous les corps sont politiques. »
Pour compléter cet article , voici le lien vers une vidéo :
et le conseil lecture de l’autrice qui a largement inspiré cet article :
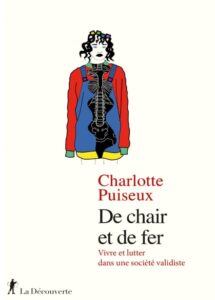
« De chair et de fer » de Charlotte Puiseux aux Editions La Découverte